Comment les espaces de coworking peuvent être à l’origine de nouvelles communautés ? Comment peuvent-ils leur permettre de se fédérer et de s’organiser plus efficacement ? Voilà des questions centrales pour les Mutins car – on ne le dira jamais assez – le succès d’un espace de coworking dépend avant tout de sa capacité à faire naitre, à rassembler et à faire croitre une communauté. Pour cela, il faut d’abord essayer de comprendre ce qu’est exactement une communauté. Comment elle nait, comment elle s’organise et comment elle peut disparaître…
Un patrimoine commun
la découverte de l’origine étymologique du mot communauté m’a mis en joie ; le mot vient du latin cum numus, c’est un groupe de personnes ; cum qui partagent quelque chose ; numus, un bien, une ressource ou au contraire une obligation, une dette… Ainsi, le partage serait à l’origine de la constitution des communautés… C’est beau ! Et cela rejoint une idée mutine avancée lors d’un article précédent ; l’échange, le don et le lien social.

Naissance des communautés
Mais quels peuvent être ces patrimoines communs ou ces dépendances à un même élément, capables de fonder de nouvelles communautés ?
Un territoire ou un lieu commun
D’abord, il peut s’agir d’un territoire ou d’un lieu fréquenté régulièrement par plusieurs individus. A force de s’y retrouver, des liens pourront se créer ce qui pourra donner naissance à une communauté de lieu. Les relations qui naissent sur les lieux de travail, dans les écoles ou les villages peuvent donner naissance à ce genre de communauté.
Des ressources partagées
La mise en commun des ressources est un facteur majeur de création de communautés. Que ce soit un puits où chacun vient s’abreuver, une usine ou une maison familiale, le fait de partager et de dépendre de certaines ressources favorise la création de lien social.
Une langue commune
La langue est aussi un patrimoine commun, partagé de manière indivisible par telle ou telle population. Par conséquent, elle permet d’être la base d’une communauté. La communauté des partisans de l’esperanto est un exemple de la fondation d’une communauté par la langue.
Une mémoire, une histoire commune
L’appartenance à un passé commun, réel, romancé ou fantasmé est un facteur d’unité et un moyen de rassembler les hommes. Dans l’antiquité, la création d’un passé mythique a joué un rôle important dans la constitution d’une identité grecque, juive ou romaine. Sous la IIIème république, les figures de héros nationaux tels que Vercingétorix ou Jeanne d’Arc ont été mises en avant pour renforcer l’unité nationale.
Des connaissances et des techniques partagées
Les cercles de penseurs, les communautés scientifiques, les corporations de métiers sont autant d’exemples de communautés constituées autour de savoirs ou de techniques partagées.
Des valeurs, centres d’intérêt ou idéaux communs
Enfin, certaines communautés sont constituées autour de valeurs, de centres d’intérêt ou d’idéaux communs. les communautés religieuses, les familles politiques ou encore les clubs de sport appartiennent à cette catégorie.
En pratique, les communautés s’imbriquent les unes dans les autres. Les communautés qui naissent au sein d’une entreprise par exemple, peuvent être à la fois communautés de lieu, de ressources, de connaissances, d’histoire et de valeurs. Les communautés les plus solides sont celles capables de réunir un maximum de patrimoine commun. Il existe toutefois un risque inhérent au fait de partager un trop grand patrimoine commun, celui de tomber dans une sorte de consanguinité culturelle, de se refermer, et de sombrer dans le communautarisme… Pour éviter cela, les communautés les plus complètes doivent veiller à rester ouvertes et réceptives à d’autres influences.
Comment peut naitre une communauté dans un espace de coworking ? En partageant le même lieu, les mêmes ressources, en mettant en commun leurs idées et leurs compétences, les coworkers multiplient les occasions de fonder de nouvelles communautés.
L’âge adulte
La communauté s’oppose à la société et à l’association en ce qu’elle est formée indépendamment de la volonté de ses membres et qu’ils ne décident pas de leur implication.
Une communauté n’est pas nécessairement un groupe opérationnel, elle peut exister d’elle-même, sans que ses membres en soient réellement conscients. Elle peut exister sans projet nettement formalisé ni leader établi.
Il arrive toutefois que la communauté finisse par prendre conscience d’elle-même et décide de s’organiser. C’est là, sans doute, le véritable acte de naissance d’une société. En me renseignant sur le sujet, je suis tombé sur Ferdinand Tönnies, sociologue et philosophe. Lisez plutôt : « Tönnies explique, à travers les notions de volonté organique (Wesenwille) et celle de volonté réfléchie (Kürwille), le passage de l’individu de la communauté (Gemeinschaft) vers la société (Gesellschaft). Pour lui, la volonté organique est à l’origine de la forme de vie sociale communautaire. Elle est une spécificité du comportement des individus vivant en communauté, caractérisée par l’attachement, l’affection qu’a l’individu, envers sa famille, son village, ceux qui y habitent et les pratiques coutumières et religieuses y existant. La forme sociale sociétale est, quant à elle, le produit de la volonté réfléchie, c’est-à-dire qu’elle est issue de la pensée humaine. »
Une société, c’est donc d’abord une communauté qui a pris conscience d’elle-même et qui a décidé de s’organiser.
Cette prise de conscience peut survenir de plusieurs manières :
- La communauté entre en contact, (pacifiquement ou non) avec une force extérieure et réalise par là même qu’elle existe.
- Un ou plusieurs leaders parviennent à faire prendre conscience de l’unité de la communauté et/ou à proposer un projet collectif.
- De nouveaux outils, de nouvelles techniques ou de nouveaux moyens de communication font prendre conscience de l’existence de communautés jusqu’à lors dispersées.
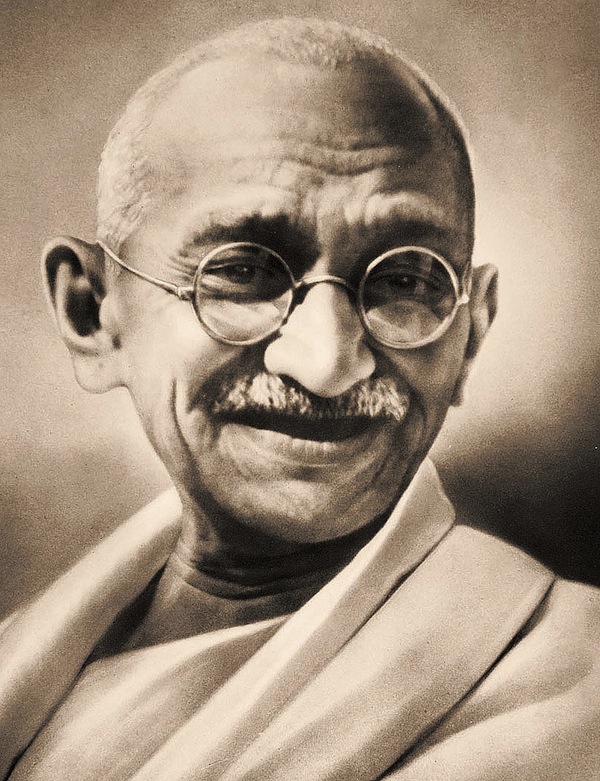 Cette prise de conscience est sans doute en train de se réaliser sur Internet. Le développement de nouvelles fonctionnalités web permettant de rassembler et d’organiser des communautés diffuses (réseaux sociaux, P2P…). La découverte de la puissance de la culture numérique et de sa capacité à influer le cours des évènements (Wikileaks, Anonymous) et le sentiment d’agression perçu par les communautés numériques (répression numérique en Tunisie, Egypte, Iran, chine, lois Hadopi…) sont peut-être en train de transformer les communautés en ligne en sociétés en ligne.
Cette prise de conscience est sans doute en train de se réaliser sur Internet. Le développement de nouvelles fonctionnalités web permettant de rassembler et d’organiser des communautés diffuses (réseaux sociaux, P2P…). La découverte de la puissance de la culture numérique et de sa capacité à influer le cours des évènements (Wikileaks, Anonymous) et le sentiment d’agression perçu par les communautés numériques (répression numérique en Tunisie, Egypte, Iran, chine, lois Hadopi…) sont peut-être en train de transformer les communautés en ligne en sociétés en ligne.
Comment les espaces de coworking peuvent permettre de fédérer, de renforcer et d’organiser les communautés existantes ? Comment peuvent-il transformer les communautés en micro-sociétés ? Internet a vu naitre un nombre impressionnant de communautés qui n’avaient pas de lieux physiques pour se rassembler et s’organiser. Les espaces de coworking peuvent remédier à cela ; ils permettent aux micro-sociétés en puissance de se réunir, d’y organiser des évènements ou encore de s’y former pour être plus efficace dans leurs actions collectives.
La mort des communautés
Lorsqu’une communauté perd le patrimoine commun qui fait son unité, elle perd du même coup sa raison d’être.
Une communauté n’a plus lieu d’être si elle n’a plus rien à partager.
Je vois 3 causes de mortalité principales pour une communauté :
- le patrimoine commun disparait : Suite à un changement technologique, culturel, politique ou idéologique, l’élément commun qui faisait l’unité de la communauté disparait. Ce patrimoine peut également disparaitre en cas de dispersion géographique d’une communauté ou en cas de disparition d’une ressource partagée. L’exode rural donne un bon exemple de la destruction de communautés. En quelques années, les communautés rurales unies autour d’un lieu (village), d’une ressource commune (la terre) d’un métier (agriculture), d’une mémoire commune voire d’une langue ou d’un patois local ont été délocalisées, dispersées et finalement assimilées. Elles ont laissé la place à de nouvelles communautés plus urbaines, plus industrielles…
- le patrimoine commun est confisqué : Il peut arriver, lorsque la communauté a commencé à s’organiser, que le patrimoine commun soit confisqué par une ou plusieurs personnes éminentes qui auraient été tentées de confondre « gestion » du patrimoine commun avec « appropriation » du patrimoine… l’histoire fourmille d’illustrations : idées religieuses et valeurs morales confisquées par un clergé, hommes d’Etat véreux ayant tendance à confondre les caisses de l’Etat avec les leurs, historiens malhonnêtes réécrivant l’histoire… Or si le patrimoine autrefois partagé par tous est confisqué par quelques-uns, le bien commun devient bien privé et la communauté disparait.
- la communauté n’a plus de raison d’être : Cette dernière cause de mortalité représente en quelque sorte la belle mort des communautés, celle qui survient lorsque la communauté a atteint une taille critique ou une maturité suffisante. La communauté perd alors son pouvoir fédérateur et sa vitalité, elle n’est plus un vecteur identitaire assez fort pour l’individu. Elle se scinde alors en plusieurs sous-communautés plus vivaces qui, partant d’une base commune, y ajoutent des éléments propres et créent une nouvelle dynamique.
En revanche, une société peut survivre à la communauté dont elle était issue. De la même manière qu’un récif de corail continue de garder sa structure longtemps après que ses micro-organismes soient morts, les structures sociales peuvent perdurer un temps mais elle perdent alors leur vitalité, deviennent rigides, cassantes et finissent par s’effriter progressivement…
Tableau récapitulatif :

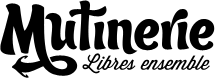



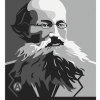



Cette reflexion sur la nature d’une communaute est vraiment interessante et tres appreciable en parallele de votre espace de coworking…
Avez vous eu des retours d’espace de coworking deja existants? Est ce que des communautes sont reelement nees? Y a t il eu a l’inverse des echecs du type « une bande de gens perdus juste en quete d’un endroit ou s’assoire et qui ne partage pas ce BIEN commun »?
Apo, Je te réponds avec moult retard, j’en suis confus. Oui nous avons de nombreux témoignages de naissances de communautés par le coworking. Nous n’avons pas seulement des témoignages, nous en avons d’hors et déjà l’expérience. Nous avons eu un lieu durant un mois et malgré ce temps très bref, quelque chose est a pu y naitre. Le crew qui s’est formé à Mutinerie 1.0 se réunit encore très souvent pour des raisons à la fois professionnelles et extra professionnelles. Ca fait chaud au coeur et ça nous donne encore plus la foi dans le concept !
Eviter l’effet « bande de gens perdus qui ne partagent pas le bien commun », c’est l’une des missions majeures de ceux qui sont en charge de l’espace de coworking.
salut Apo,
voici quelques espaces de coworking qui on été particulièrement performants dans la création – gestion – mobilisation de communautés :
http://www.indyhall.org/
http://coherecommunity.com/
http://officenomads.com/
http://betahaus.de/
des echecs ils y en aussi (http://www.deskmag.com/en/when-coworking-doesn-t-work), ils découlent souvent d’une incompréhension de ce que signifie vraiment le coworking. on ne va pas te dresser la liste des partage en couilles mais le motif d’échec le plus souvent avancé est justement la non existence de communauté (du genre ouvrir un lieu, se mettre à chercher des gens et devoir fermer au bout de quelques mois faute de pouvoir payer le loyer). il existe aussi des espaces viables économiquement consistant de fait à de la location de bureau flexible sans réelle plus-value sociale. ça dépend de vibe quoi…
Bonjour William, encore un article très intéressant, merci et bravo.
Quelques idées qui me sont venues à la lecture :
1) Alain Supiot, lors de son discours d’entrée au collège de France (p 10 de son texte), évoque bien l’ambiguïté des solidarités de voisinage ou d’affinité dans leur lien avec la société : d’un côté elles peuvent recréer un sens à la solidarité et restaurer la légitimité de la solidarité nationale (celle de l’Etat, qui est constitutive de la société), de l’autre, elles peuvent aussi saper les bases de celle-ci et précipiter un mouvement de repli communautaire. En même temps (et là a contrario), on peut observer aux EU des espaces de coworking fondés sur une forme de communautarisme religieux et pourtant relativement ouverts (cf. l’exemple d’un espace de cowo cité sur son blog par Clay Spinnuzi, chercheur sur le coworking, et animé par une église (« church »)) :
- Supiot toujours : « L’Histoire montre que les époques de crise économique et politique font resurgir des pactes d’amitié inspirés du modèle familial, telles ces frérèches observées dans le Languedoc du XVe siècle par Emmanuel Le Roy Ladurie, qui explique leur essor par l’incapacité des institutions publiques de fournir à l’individu la protection matérielle et morale qu’il est en droit d’en attendre. La perte de foi dans l’autorité tutélaire de l’État et sa capacité protectrice est un terreau favorable à l’éclosion des formes les plus diverses de solidarité, au premier rang desquelles les solidarités familiales ou territoriales, dont l’analyse économique nous montre le rôle crucial qu’elles continuent de jouer. » Ici la création de communautés est analysée comme une forme de réaction à l’incapacité du niveau supérieur (l’Etat, la société mais aussi l’entreprise) à fournir protection morale et matérielle…
2) Un facteur me semble très important pour fonder des communautés qui tiennent, et apparaît beaucoup dans les entretiens que j’ai pu faire avec des coworkers. C’est aspect affectif et émotionnel. On pourrait utiliser le terme que Lordon emprunte souvent à Spinoza d’ « affects joyeux ».
J’ai trouvé dans beaucoup d’entretiens une mauvaise expérience du monde du travail, ou une expérience qui a lassé et généré beaucoup d’affects négatifs. L’espace de coworking correspond alors à une forme de « reconstruction réactionnelle de commun » dans laquelle les coworkers sont portés à se retrouver et à se regrouper pour éprouver la joie d’être affectés et d’affecter les autres joyeusement. Cette dimension m’apparaît importante pour comprendre la dynamique de ces espaces, dimension essentielle et pourtant fondamentalement oubliée des organisations de travail classiques.
Merci Bénédicte,
Je ne connaissais pas Alain Supiot, merci pour la trouvaille !
Effectivement, la communauté peut libérer comme elle peut asservir. Toutes les communautés naviguent dans cette ambiguité, et la seule réponse est dans le dosage. La difficulté de maintenir une communauté équilibrée sur le long terme est qu’à mesure que sa vie se prolonge elle tend à se formaliser, se complexifier, se structurer… Le temps fabrique des héritiers qu’on le veuille ou non. Tout cela change la nature de l’adhésion à la communauté. D’une adhésion joyeuse et libre, on en arrive à une adhésion par défaut ou par intérêt et l’on bascule lentement dans une communauté qui n’étouffe plus qu’elle ne libère… Et cela génère ensuite des réactions.
Que des communautés sapent les bases d’un Etat, ou d’une organisation qui a dépossédé les gens de leurs biens communs ne me gêne pas forcément du moment qu’elles le font en créant des alternatives viables. Cela me parait au contraire parfaitement légitime.
Ton point 2 est très intéressant et me parait être un élément fondamental mais aussi très souvent oublié dans la construction d’une communauté . Je dirais cependant que cet aspect ne doit pas être le seul lien dans la communauté, on doit aussi avoir des raisons plus objectives de se retrouver, un projet commun, un outil commun etc… Lorsque l’on ne possède que l’affect joyeux, on s’expose à « l’effet hippies »; être ensemble pour célébrer, échanger, partager mais l’absence de construction réelle finit par tarir la source…