Le terme communauté appartient à ce genre le mot qui échappent à la rigueur d’une analyse profonde et qui restent bien souvent évanescents, flous, et un peu mystique. Le genre de mot qui autorise tout sans avoir besoin de se justifier. C’est dommage, d’autant que nous vivons une époque où les communautés font leur grand retour, pour le meilleur et pour le pire.
Au XXème siècle, on a voulu penser le pays comme une infrastructure mais l’histoire récente nous montre que ce n’est pas vrai, ou du moins que ça n’est pas suffisant. Les logiques de communauté se retrouvent partout, du club de tennis au mouvement politique, de la grande entreprise au petit village, dans les religions et dans les cultures…
Les communautés ne sont pas non plus dénuées d’intentions ni d’objectifs, elles sont des organismes vivants qui veulent exister, s’affirmer, perdurer et prospérer. Elles sont capables pour cela d’appliquer des stratégies.
Pour tenter de remédier (un peu) à notre déficit d’outils nous permettant de mieux comprendre les logiques de communauté, je vous propose une typologie qui permettra peut-être de nous aider à mieux situer, à mieux comprendre les différentes stratégies et les modes d’organisation qu’elles mettent au point pour vivre et se développer.
Partons du principe qu’une communauté, comme toute espèce vivante, a pour objectif de rester vivante et de croitre. Ces deux objectifs ; la résilience et la viralité sont donc les piliers de toute communauté. C’est assez basique bien sûr, mais c’est un bon début car ça s’applique à peut près à tout type de communauté.
Quels sont donc les grands axes stratégiques sur lesquels ces communautés peuvent jouer pour atteindre ces deux objectifs ? J’en ai relevé quatre qui feront l’objet chacun d’un article :
1)Le niveau d’ouverture de la communauté
2)Son homogénéité
3)Son niveau de structuration interne
4) Communautés d’intérêt ou communautés de valeur.
1)Ouverture / Fermeture

Un des éléments indispensables qui régit la vie de toute communauté est la question de son niveau d’ouverture. Est-il facile d’entrer et de sortir de la communauté ? L’entrée dans la communauté suppose-elle une certaine exclusivité ou d’autres formes de sacrifices initiatiques ? La communauté a-elle beaucoup d’interaction avec l’extérieur ?
La question du niveau d’ouverture est celle qui touche la plus directement
à l’aspect viral des communautés. C’est en quelque sorte son organe reproducteur !
Mais il touche aussi indirectement à la « durée de vie » de ses membres, car les communautés ouvertes ont tendance à avoir un « turn over » important. Evidemment le dosage ouverture/fermeture optimal dépend fortement de l’objectif que se donne une communauté et du contexte dans lequel elle évolue et pourra évoluer avec le temps. Un commando révolutionnaire souhaitant renverser le régime au pouvoir n’a pas franchement intérêt à avoir pignon sur rue et accepter n’importe qui dans ses rangs. Il a en revanche intérêt à avoir des membres très bien formés et à développer une grande confiance mutuelle. De même, un parti politique justifiera difficilement de n’accepter que les électeurs, ayant passé 10 ans à en étudier ses fondements idéologiques …
au pouvoir n’a pas franchement intérêt à avoir pignon sur rue et accepter n’importe qui dans ses rangs. Il a en revanche intérêt à avoir des membres très bien formés et à développer une grande confiance mutuelle. De même, un parti politique justifiera difficilement de n’accepter que les électeurs, ayant passé 10 ans à en étudier ses fondements idéologiques …
Communautés fermées : « La garde meurt mais ne se rend pas! »
Une communauté plus fermée est généralement plus mobilisable, plus tournée vers l’action. Ses membres sont choisis sur des critères plus stricts. Les liens entre les membres sont généralement plus denses. La confiance interne et la solidarité y sont fortes.
Chaque individu en retire un avantage conséquent (en échange généralement d’un sacrifice important) ce qui la rend apte à se défendre dans l’environnement qu’elle connait mais le fait qu’elle soit moins virale et que la diversité entre les membres est généralement moins importante la rend plus sensible aux chocs violents car elle aura du mal à se reconstituer rapidement si elle perd ses membres et à s’adapter si son environnement évolue.
Dans l’antiquité, Sparte nous donne un bon exemple d’une communauté extrêmement fermée. Les conditions pour devenir citoyen sont drastiques, il faut que les deux parents aient été citoyen ou fille de citoyen, avoir reçu la rude éducation spartiate et avoir suffisamment de revenu pour contribuer à la vie de la cité. Tout est fait pour renforcer la cohésion entre les citoyens et l’esprit de sacrifice y est poussé au maximum. Alors oui, leur armée était redoutable mais cela n’empêchera pas Sparte
nous donne un bon exemple d’une communauté extrêmement fermée. Les conditions pour devenir citoyen sont drastiques, il faut que les deux parents aient été citoyen ou fille de citoyen, avoir reçu la rude éducation spartiate et avoir suffisamment de revenu pour contribuer à la vie de la cité. Tout est fait pour renforcer la cohésion entre les citoyens et l’esprit de sacrifice y est poussé au maximum. Alors oui, leur armée était redoutable mais cela n’empêchera pas Sparte de mourir piteusement ne pas avoir assez ouvert leur critères de citoyenneté et d’être restés figés dans un conservatisme radical et la reproduction aveugle de leur splendeur passée. Les historiens estiment que, de près de 10 000 citoyens vers 650 avant notre ère , elle finit par en compter
de mourir piteusement ne pas avoir assez ouvert leur critères de citoyenneté et d’être restés figés dans un conservatisme radical et la reproduction aveugle de leur splendeur passée. Les historiens estiment que, de près de 10 000 citoyens vers 650 avant notre ère , elle finit par en compter moins de 1 200 vers -300. Triste fin…
moins de 1 200 vers -300. Triste fin…
Avantages :
- Loyauté et stabilité des membres
- Grande confiance mutuelle
- Communauté mobilisable et capable de se défendre
Inconvénients :
- Faible viralité
- Faible capacité d’adaptation sur le long terme
- Appartenance ayant tendance à être exclusive vis à vis d’autres communautés.
Communautés ouvertes : « Fluctuat nec Mergitur »
Les communautés ouvertes n’appliquent pas des critères de sélection stricts et accueillent facilement ceux qui veulent la rejoindre. Parfois, il n’existe même pas de formalisation d’appartenance à la communauté ; on l’est à partir du moment ou l’on remplit certains critères objectifs. Une communauté plus ouverte accueillera plus de membres mais en perdra également plus en route car l’identité moins affirmée, le soin moins important généralement accordé aux nouveaux membres et les grandes possibilités de sortie qu’elle offre
membres et les grandes possibilités de sortie qu’elle offre (en étant moins exclusive) entrainent des déperditions importantes.
(en étant moins exclusive) entrainent des déperditions importantes.
Les membres d’une communauté très ouverte manifestent souvent moins de solidarité interne et sont moins mobilisables en cas de crise. En revanche, cette viralité et ce taux de renouvellement important génère une plus grande capacité d’adaptation grâce à la plus grande diversité des profils et au fait que chaque nouveau
membre apportera plus facilement des solutions nouvelles.
Les communautés ouvertes tolèrent donc de plus grandes variations d’effectifs et sont capables de s’adapter facilement aux changements de l’environnement dans le temps et dans l’espace. Elles mutent, fluctuent, plient mais ne se rompent pas.
Peu de communautés sont à la fois aussi ouvertes et aussi universelles que les communautés du football. Ouvertes car elles n’exigent en principe qu’un prérequis minimal : avoir deux jambes, et universelles car le foot est pratiqué avec passion absolument partout sur la planète ! Chaque pays, chaque club développe des styles de jeu, des sous cultures, des modes d’organisation différents selon les lieux et les périodes. Le nombre d’inscrits varie fortement d’une année à l’autre, selon les résultats de tel club local, de telle équipe nationale, de l’activité de tel entraineur, de la médiatisation de la discipline mais le football, malgré les aléas et les fluctuations locales forme une communauté d’une résilience phénoménale !

Avantages :
- Viralité importante
- Grande capacité d’adaptation.
- L’appartenance à la communauté n’est pas exclusif
Inconvenients :
- Faible stabilité des membres
- Difficultés d’intégration des nouveaux
 venus
venus - Communautés difficiles à mobiliser et peu de solidarité interne
Les stratégies d’ouverture
Puisque les communautés sont des organismes vivants, quoi de mieux qu’un peu de stratégie biologique pour tenter d’y voir plus clair ?
plus clair ?
En biologie, on peut comparer les stratégies des communautés fermée aux stratégies K utilisées pour décrire les organismes vivants dont la stratégie repose sur une croissance faible de la population mais un taux de mortalité également faible et des individus très adaptés pour faire face à une situation donnée. Cette stratégie est considérée comme plus efficace dans les environnements à la fois stables et compétitifs.
Les communautés ouvertes emploient des stratégies comparables aux stratégies r, basées sur un taux de reproduction important et un fort taux de mortalité est considérée plus efficace dans les environnements instables et imprévisibles. Dans le règne animal, les lemmings sont d’emblématiques représentants de cette stratégie !
En pratique, entre ses deux extrêmes, il existe évidement une très large palette de nuances. Certaines communautés peuvent avoir une base très ouverte mais un sommet extrêmement étroit. Tous sont appelés mais peu seront élus ! Un mécanisme de sélection interne fondés sur le talent individuel se chargeant d’écrémer, au sein même de la communauté et d’y instaurer une hiérarchie interne. Cette stratégie se retrouve dans la nature chez les lions ou les cerfs, où seuls quelques mâles dominants peuvent accéder au sommet après avoir montré leur valeur. Dans les sociétés humaines, on retrouve ces logiques le plus souvent en politique, ou dans les disciplines sportives !
D’autres communautés peuvent être très sélectives dans leur recrutement mais par ailleurs rester en interaction constante avec d’autres communautés. Des cercles de chercheurs par exemple, peuvent constituer un noyau dur presque étanche tout en étant en contact avec des scientifiques de tout bords, des étudiants, des hommes politiques, etc. Ce genre de stratégie est souvent utilisée par des experts ou des influenceurs.
mais par ailleurs rester en interaction constante avec d’autres communautés. Des cercles de chercheurs par exemple, peuvent constituer un noyau dur presque étanche tout en étant en contact avec des scientifiques de tout bords, des étudiants, des hommes politiques, etc. Ce genre de stratégie est souvent utilisée par des experts ou des influenceurs.
Enfin, gardons en tête qu’une communauté ne choisit pas toujours librement son niveau d’ouverture et agit sous contrainte. Si elle est mal acceptée dans son environnement, elle tendra naturellement à se refermer car l’appartenance à cette communauté deviendra un acte qui exclut de fait ses membres d’appartenir à d’autres communautés.
On se retrouve alors dans un schéma où chacun devra choisir son camp, et chaque camp aura de moins en moins d’échanges et d’intérêts croisés ce qui est à terme, préjudiciable à tout l’écosystème social. Ce mécanisme communautariste est un grand (et dangereux) classique…
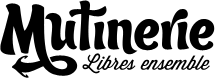




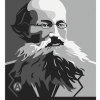



Merci pour cet article très instructif et qui nous donne un angle intéressant dans la compréhension de ce que sont les communautés. J’attends la suite.