Depuis les années 90, la population rurale est repartie à la hausse en France après plus de 150 ans de baisse continue. La hausse est certes modeste et concerne davantage les périphéries urbaines que les zones véritablement rurales mais elle met fin à un processus présenté comme inéluctable. Plus d’un Francilien sur deux souhaiterait aujourd’hui quitter l’Ile de France ! Et la moitié des candidats au départ se projettent dans une ville petite ou de taille moyenne (moins de 100 000 habitants), devant la campagne (26%) ou la grande ville (18%).
Derrière ce phénomène de retour aux campagnes se cachent des réalités très différentes qui, à mon sens ne permettent pas de conclure à un véritable exode urbain; enchérissement des centres-villes entrainant une fuite vers les périphéries par le mitage des campagnes alentour, fermetures de bassins industriels urbains, augmentation des retraites en zones rurales, fuite des villes pour cause de pollution ou d’insécurité …
L’essentiel du contenu que l’on peut trouver dans les publications suit le même angle d’attaque qui, à mon sens passe à coté de la question de fond. Car il ne suffit pas de constater un mouvement allant des centres vers les périphéries pour conclure à un authentique exode urbain.
La raison principale de l’exode rural fut économique et technologique. Avec la révolution industrielle, les besoins en main d’oeuvre et les revenus chutaient dans l’agriculture alors qu’ils explosaient dans l’industrie. Pour subsister, les populations agricoles sans activité se sont exilées vers les bassins industriels avides de main d’oeuvre.
De la même façon, pour savoir si nous sommes véritablement en train d’assister à un exode urbain, il faut se poser les questions suivantes :
Les zones rurales sont-elles en train de devenir économiquement plus attractives que les villes sur le plan économique ? Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre les causes et les caractéristiques de ce phénomène naissant ?
Evidemment, la vérité est rarement pure et jamais simple. Ce qui suit n’a pas vocation à s’appliquer uniformément partout comme une règle absolue.
Un exode urbain numérique
Dire que les technologies numériques favorisent la mobilité et le travail à distance est presque un lieu commun. Mais il n’en reste pas moins que cet élément est central si l’on veut appréhender l’exode urbain. Plus important, la révolution numérique doit être comprise comme une authentique révolution, non pas comme un simple outil pratique.
La première lecture, c’est que les moyens numériques permettent techniquement de travailler depuis n’importe où. Les technologies actuelles permettent à un travailleur d’accomplir avec un ordinateur et un téléphone, des choses qui nécessitaient, il y’a seulement une quinzaine d’année, un ensemble d’équipements lourds et coûteux. Dans de nombreux métiers, Internet donne à chacun l’accès à un marché de millions d’individus et peu importe que vous viviez à Paris ou au fin fond de l’Ardèche…
Même dans les secteurs non directement liés à l’économie de la connaissance, les moyens de production s’allègent et se décentralisent. On le voit avec des exemples très concrets tels que les imprimantes 3D ou d’autres exemples de productions décentralisées. Mais les moyens numériques permettent un meilleur usage des choses et une meilleure accessibilité des biens d’usage non courant à travers les nouvelles pratiques collaboratives.
La deuxième lecture consiste à voir, au delà des aspects technologiques, ce que le numérique ouvre sur le champ des possibles. Les révolutions néolithiques et industrielles commencent avec des innovations technologiques qui facilitent l’existence. Mais très vite, elles finissent par tout changer, notre rapport à l’espace, aux autres, à nous-même… Elles redéfinissent nos logiciels de pensée.
De la même manière que la révolution industrielle déplace les sources de valeur de l’agriculture vers l’industrie, la révolution numérique déplace la valeur de l’industrie vers la production intellectuelle.
Or, la production intellectuelle (ou cognitive) n’est pas dépendante des infrastructures matérielles complexes que l’on trouve essentiellement dans les villes, elle dépend de la richesse d’un écosystème qu’il soit urbain, rural ou même virtuel. L’avantage économique des villes, qui était déterminant dans l’ère industrielle, perd ici une partie de sa substance.
Un exode urbain mené par des indépendants
Il n’y aura pas de véritable exode urbain tant que les zones rurales ne pourront être considérés comme de véritables zones d’attraction économiques. Mais, par « zones d’attractions économiques » ne voyons pas là des transpositions des modèles qui firent le succès de l’âge industriel. L’exode urbain ne doit pas être appréhendé avec les idées et les armes d’hier.
la campagne n’a jamais été le terreau adapté au salariat. L’exode rural concernait essentiellement des indépendants (agriculteurs, artisans…) quittant ce mode de travail pour le salariat et il est à parier que l’exode urbain s’inscrira dans le mouvement inverse.
Il existe une corrélation très nette entre le mouvement d’urbanisation de l’occident et celle du nombre de travailleurs indépendants. En 1830 en France, on compte encore 50% d’indépendants dans la population active dans une France encore largement rurale. En 1930, ils ne sont plus que 33%. Après une stabilisation du ratio pour cause de Grande dépression (qui est une essentiellement une crise du capitalisme industriel) et de guerre mondiale, la chute du nombre de travailleurs indépendant reprend de plus belle, encouragée par les Etats occidentaux. En 2007, ils représentent moins 10% de la population active comme le montre cet excellent rapport intitulé « le travailleur indépendant, figure du XXIème siècle » . Le lien entre industrialisation, exode rural et diminution du nombre d’actifs indépendant est net.
Or le nombre d’indépendants ne cesse d’augmenter dans tous les pays industrialisés. En France, nous sommes passé de 9,6% d’indépendants en 2007 à 11,6 fin 2012. On estime les populations d’indépendants aux Etats-Unis à 35 millions contre 27 millions en Europe. Cette augmentation numérique rapide, s’accompagne d’une revalorisation nette du travail indépendant par rapport au travail salarié.
L’exode urbain sera principalement mené par des indépendants. Sur le terrain, c’est ce que constate Xavier de Mazenod, fondateur de Zevillage, un site d’information, et un réseau social sur les nouvelles formes de travail. Xavier lui-même a quitté l’Ile de France pour s’installer à Boitron un petit village dans l’Orne. Il est à l’initiative d’un télécentre dans son village. »Sur 12 travailleurs, on ne compte que 3 salariés dans l’espace. Le modèle du télétravail salarié ne prend pas vraiment dans les campagnes ». Et de fait, l’expérience du télétravail sur le modèle salarié n’est pas récente, elle commence dès le milieu des années 80 et n’a toujours pas réellement donné de résultats incontestables.
Les zones rurales, vastes et peu denses requièrent une forte dose d’autonomie et de polyvalence, éléments assez peu compatibles avec le salariat traditionnel. Elles conviennent bien mieux aux indépendants, capables de gérer leur emploi du temps et leurs déplacements.
Dans l’agriculture, il est impossible de compter le travail en terme de productivité horaire selon des créneaux bien définis. Ce qui compte, c’est être disponible dans les moments importants (récoltes, intempéries, opportunités, incidents…). Cette qualité est également centrale chez les indépendants et les entrepreneurs de l’économie cognitive.
L’indépendant peut travailler au moins une partie de son temps à distance bien plus facilement que le salarié, il n’a pas besoin de s’implanter dans un endroit où la main d’oeuvre est accessible, il est mobile et peut se déplacer avec tout ce qui lui est nécessaire si besoin. Cela le rend mieux à même de profiter réellement du coût plus faible de la vie rural.
Emmanuelle Pometan, fondatrice de l’Agence Nouvelle Culture a quitté Paris il y’a 6 mois pour s’établir dans la Drôme d’où elle travaille l’essentiel de son temps. Elle remonte à Paris trois fois par mois. « je n’ai perdu aucun client depuis que je me suis installée dans la Drôme, je n’ai raté qu’un seul rendez-vous. D’autre part, l’image de mon entreprise n’a pas souffert auprès des clients, bien au contraire, ils trouvent ça très moderne ».
De l’espace fonctionnel à l’espace comme écosystème
« Les gens qui disent que le travail localisé est mort travaillent dans une industrie définie par un lieu : la Silicon Valley. Ceci veut dire que l’espace compte encore. C’est l’un des facteurs de changement les plus importants. »
Jim Keane, Vice-président de Steelcase
Les modes de vie sont inévitablement liés aux moyens de subsistance. Et ces moyens évoluent, au fil du temps et des avancées technologiques. Historiquement, les peuples ont commencé à se sédentariser à partir de la révolution néolithique. Le passage d’une vie de chasseur-ceuilleur à une vie où le moyen de subsistance, lié au sol, impose de rester sédentaire a totalement bouleversé les rapport sociaux et les modes de vie. La vie sédentaire agricole ayant besoin d’espace, elle appelle à un peuplement extensif réparti sur les vastes territoires, donc à une importante population rurale. La révolution industrielle lie les hommes, non plus à la terre mais à des usines ou à des mines, sur un modèle de développement intensif qui entraine l’apparition de villes à la vocation nouvelle.
Ces villes industrielles ne sont plus considérées comme des zones de friction et d’échange, visions qui prévalaient avant la révolution industrielle, mais comme des méta-infrastructures nécessaires à la production.
C’est la ville fonctionnelle développée par Le Corbusier qui devint le modèle dominant de la reconstruction d’après guerre et dont la conséquence directe fut la séparation des villes en « fonctions »; vie, travail, loisirs et infrastructures de transport. Les grands ensembles de banlieue, les cités dortoirs, les centres d’affaires, les centres commerciaux sont les héritiers de cette vision fonctionnaliste. En fluidifiant les fonctions urbaines et en décomposant les villes, celles-ci sont devenues de véritables broyeuses à externalités positives qui étaient la raison d’être des villes autrefois et qui seront sans aucun doute à nouveau la raison d’être des villes de la révolution numérique dont la productivité dépend de la pollinisation et la captation d’externalités positives. Les villes dominantes de la révolution numérique seront capables de générer des rencontres riches et authentiques, de la sérendipité, du lien social, du sentiment d’appartenance et de la confiance. Si la question des villes à l’heure numérique vous intéresse, j’avais écrit un article sur la , intitulé « cité digitale, cité idéale » …
La révolution numérique, n’abolit pas l’espace, elle le transforme. Elle lui donne un sens et des usages nouveaux.
Et le nouvel usage de l’espace, c’est d’être non plus une infrastructure, mais un écosystème. Un cadre général favorable à telle ou telle activité. Un écosystème se compose d’une multitude de paramètres en interaction permanente. Il suppose du frottement et un croisement des usages
L’exode urbain sera donc vraisemblablement porté par des espaces multifonctionnels. Un exemple déjà concluant en zone rurale est celui des points multiservices permettant par exemple à une boulangerie de proposer des services de retrait d’argent, d’information touristique etc… Cela pérennise l’activité des commerçants locaux, facilité l’accès aux services en zone rurale et permet d’assurer une mission de service public à moindre coût. Exemple d’approche écosystémique réussi.
Xavier de Mazenod souligne l’importance du multiservice en zone rurale « l’idée qu’un lieu égal une fonction ne peut pas marcher en zone rurale » Le télécentre de Boitron accueille des activités très variés; initiations à l’informatique, fêtes ou même élections …
Dans la révolution numérique, l’environnement remplace l’infrastructure et le projet remplace le métier. pour chaque activité peuvent correspondrent différents environnements appropriés.
Dans cette logique, la ville offre un écosystème favorable à certaines activités. On y trouve plus aisément des clients et des partenaires, on y promeut efficacement ses activités, on dispose d’un accès facile à l’information …
La campagne permet une meilleure concentration et une capacité d’exécution accrue. Elle permet une prise de recul et une meilleure capacité de synthèse…
Emmanuelle apprécie l’alternance entre le travail en zones rurales et le travail en zones urbaines. Elle voit cette alternance comme un atout pour sa productivité.
La bonne décision économique pour le travailleur cognitif aujourd’hui n’est-elle pas de pouvoir profiter de cette diversité d’écosystème selon les besoins de son activité ? Ce sera peut-être une question déterminante pour les travailleurs de demain, prêts à évoluer comme des nomades, saisissant dans les différents environnements qu’ils traversent, ce qui est nécéssaire à la réalisation de leurs activités.

Le coworking pourra-il accompagner et encourager ces tendances ?
Le coworking est né de la culture numérique. Il concerne des indépendants mobiles, voire nomades et privilégie une approche par écosystème. Alors vu comme ça, il apparait comme un excellent candidat pour devenir l’un des fers de lance de l’exode urbain.
Et de fait, le coworking se développe en zone rurale et parait très prometteur. Il existe déjà plusieurs initiatives de coworking ruraux comme Arrêt Minute en Aquitaine.
De son coté, l’équipage mutin, toujours assoiffé d’experience, se lance dans l’exploration du coworking en milieu rural. Notre terre d’élection; le Perche. Notre mission; développer un écosystème favorable pour les travailleurs indépendants percherons ou aspirant percherons. Créer une « Percheronne Vallée » dans les vallons harmonieux du Parc Naturel. Nous partons vendredi prochain pour un weekend pour la Loupe dans le Perche. Pour suivre nos aventures Percheronnes sur Facebook, c’est ici. Et pour vous inscrire au Jelly prévu vendredi soir, c’est là !
Le 21 mars au comptoir Général à Paris se déroulera la restitution du Tour de France du Télétravail Mené par Néo-nomade et Zevillage. ce sera l’occasion d’avoir un retour d’experience très riches des initiatives de travail en milieu rural.
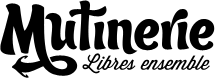




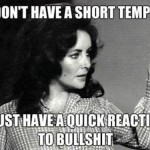
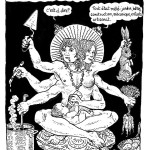

Bien vu les mutins. Pour nourrir votre réflexion, êtes vous aussi passés au Pavillon de l’Arsenal ? L’expo Work in Process envoie du bois.
http://www.pavillon-arsenal.com/expositions/thema_modele.php?id_exposition=252
Magnifique article. Grand grand merci
Au Portugal, Frederico Lucas se bat depuis longtemps pour cette migration vers la campagne. « Novos Povoadores » (Nouveaux Colons) c’est son project.
https://www.facebook.com/frederico.slucas
Je suis fondateur de Coworklisboa, le premier cowork à Lisbonne (depuis 2010).
Trés bon article, bravo!
Hello Fernando ! Nous travaillons nous même sur un endroit à la campagne. Merci pour la référence à l’initiative de Federico ! Très intéressant
Réflexion très stimulante ! Intéressant de rappeler les similitudes entre le travail agricole, paysan, et les caractéristiques du travail indépendant. Dans la recherche sur le coworking que nous menons en ce moment à l’université de Lille 1, la métaphore du « village » apparaît très souvent dans nos entretiens : le village avec l’imaginaire de personnes qui se connaissent, se côtoient, s’entre-aident quand nécessaire, se prêtent du matériel, tout en menant leur activité de manière autonome, avec des frontières vie privée/travail difficiles à définir. Après, bien sûr, comme tout imaginaire, cela tend à idéaliser certains aspects et à en oublier d’autres, mais en tout cas l’analogie est intrigante…
Merci pour ton commentaire Bénédicte,
Je crois effectivement que l’on revient de plus en plus aux logiques de production rurales et villageoises. Plus je me penche sur les façons de travailler datant d’avant la révolution industrielle, plus je constate des similitudes avec le monde des travailleurs indépendants à notre époque hyper connectée.
Par exemple, la notion de productivité moins lié à un travail régulier et focalisé mais davantage tourné vers une forme de disponibilité et une capacité d’observation de son environnement, le rôle de la confiance et des communautés etc… On se rend compte que le système pré industriel était loin d’être irrationnel et qu’on a beaucoup de choses à apprendre de lui.
Par ailleurs, je serais très intéressé de jeter un oeil sur vos recherches universitaires, et de vous aider un peu si nécéssaire …
Une petite précision, le télécentre de Boitron a maintenant un site web : http://telecentre-boitron.com
Merci pour la citation
Super initiative ! Vous avez une idée plus précise de la date d’ouverture ?
Oui ! nous visons le 12 mars . Plus d’infos sur notre page facebook ici : https://www.facebook.com/mutinerievillage
. Plus d’infos sur notre page facebook ici : https://www.facebook.com/mutinerievillage