L’usage prime sur la possession.
Cette phrase pourrait résumer l’idée fondatrice du mouvement de la consommation collaborative. Mais je m’étonne parfois de ne pas voir beaucoup de réflexion sur ce que l’on entend par « usage » et « possession » et je m’étonne aussi de voir les deux termes mis en opposition.
Dans la plupart des cas, la motivation première de ceux qui acquièrent un bien, c’est de pouvoir faciliter l’accès aux services qu’il peut rendre à son utilisateur. Posséder permet l’accès à l’usage et ne s’oppose pas à l’usage… Posséder un bien ou louer un service sont donc deux moyens d’accéder à l’usage.
Ce qui change en ce moment, c’est qu’il est de plus en plus facile de disposer de l’usage des choses sans les posséder. Internet met chaque individu en contact direct avec potentiellement n’importe qui au monde. Les objets qui se languissaient dans leur cave et ne servaient que tous les 36 du mois peuvent désormais trouver des utilisateurs à l’échelle de tout un quartier, toute une ville …
Les objets deviennent liquides, et par conséquent commencent à obéir aux mêmes logiques économiques que les actifs liquides.
L’argent est liquide, il ne dort pas et circule en permanence. Lorsque l’on en possède, on le place dans une banque qui le place quelque part. Lorsqu’on a besoin d’argent, on emprunte et on a accès à l’usage de cet argent que l’on ne possède pas. Les biens « liquéfiés » ne font que suivre la même voie.
Dans cet âge de l’accès qui s’annonce, dans cette nouvelle économie qui facilite l’usage sans possession, il est fondamental de saisir les enjeux, de comprendre ce que recouvrent vraiment les concepts d’usage et de possession. Comme dit Rifkin, « le passage d’un régime de propriété fondé sur une notion de patrimoine amplement distribué au sein de la société à un régime qui repose sur l’usage à court terme de ressources contrôlées par des réseaux de prestataires introduit un changement fondamental dans notre perception de l’exercice du pouvoir économique. »
Usages
La richesse consiste bien plus dans l’usage que l’on en fait que dans leur possession. Aristote
Optimiser l’usage que l’on fait de ce que l’on produit, c’est l’une des missions fondamentales de la science économique. Moins de moyens permettent l’accès à plus de gens à un service donné.
Mutualiser, faire vivre des biens qui ne perdent pas à être partagés, c’est du bon sens économique. Quasiment un lieu commun depuis les 2500 ans qui nous séparent d’Aristote. C’est un bon sens qui toutefois manque bien souvent à nos économies, les yeux rivés sur des indicateurs inadaptés. L’intelligence collective et les nouveaux modes d’organisation qu’offrent Internet facilitent cette mutualisation des ressources.
Mais de quoi parle-t-on quand on parle d’usage ?
Il me semble que l’on se fait de la notion d’usage une vision souvent réductrice. L’usage ce n’est pas seulement la fonction utilitaire d’un bien. Une Ferrari remplit à peu de choses près le même usage fonctionnel qu’une 2CV ; transporter des individus d’un point A à un point B, mais sa valeur symbolique est totalement différente. Le prix de la Ferrari reflète le prestige que la voiture confère à son utilisateur.
N’importe quel bien sert en réalité de support à des usages différents. N’importe quel bien possède à la fois des usages pratiques, des usages symboliques qui permettent de communiquer avec autrui et des usages totalement personnels et subjectifs.
Si l’on prend l’exemple d’un outil aussi basique qu’un simple marteau, on peut s’amuser à imaginer quelques usages auxquels il donne accès :
- Usages pratiques : planter des clous, défoncer une porte, conclure un procès, casser des doigts, s’entrainer au lancer de marteau…
- Usages symboliques : manipuler et communiquer ce genre de charges symboliques : l’artisanat, le communisme, la puissance, la justice, le Panthéon nordique (Thor) etc …
- Usages personnels : Me rappelle un être cher a qui il a appartenu, historique riche entre le propriétaire et l’objet (c’est avec lui que j’ai construit ma première cabane), démonter l’objet pour en construire un nouveau etc…
Parmi ces exemples, on s’aperçoit que certains usages auxquels on accède lorsque l’on possède un bien, ne sont pas accessibles si on le loue. L’attachement à l’objet comme support de souvenir devient impossible lorsque l’on utilise des objets loués. De même, il est impossible de démonter, de customiser et de modifier un bien que l’on ne possède pas. Autrement dit, la location ne donne pas accès aux mêmes usages que la possession. Les conséquences de tout cela ne sont sans doute pas aussi négligeables que l’on pourrait croire.
Possessions
La possession est une amitié entre l’homme et les choses. Jean-Paul Sartre
Posseder peut gêner car il est une relation exclusive entre l’homme et la chose. Celui qui possède s’approprie quelque chose pour son seul profit et renvoie potentiellement un message à ses semblables; « ceci est à moi, passez votre chemin ». Posséder suscite la convoitise de ceux qui ne possèdent pas, provoque la méfiance des possédants et peut diviser les sociétés humaines comme cela c’est vérifié très souvent dans l’histoire.

Mais la possession n’est pas pour autant synonyme de matérialisme borné ni d’égoïsme.
- Il y a, contrairement à ce qu’on entend souvent, une dimension très spirituelle dans le fait de posséder un bien. Si l’on admet, comme pour notre modeste marteau, que l’objet possède une valeur symbolique, on conviendra qu’il possède une valeur spirituelle, car un symbole n’est rien d’autre qu’une idée contenue dans un objet.
Ainsi, on peut être attaché aux choses, non pas pour leur utilité pratique potentielle, mais pour ce qu’elles représentent comme valeurs, comme idées ou comme souvenirs …
Certains argueront que le fait d’injecter dans des biens matériels des valeurs plus élevées relèvent de l’idolâtrie. Est-ce qu’on rabaisse l’esprit en le projetant dans la matière ou est-ce qu’on anobli la matière en y injectant de l’esprit ? C’est une vraie question …
- Posseder peut créer une amitié entre l’homme et les choses car il est une relation de long terme qui engage les deux parties; l’homme parce qu’il lui revient d’entretenir et d’assumer la responsabilité de l’objet, et l’objet, parce qu’il ne pourra plus servir que son possesseur.
La location implique de rendre le bien en l’état, tandis que la possession autorise les modifications, les customisations et autres décorations. Autant de facteurs qui favorisent l’innovation …
- D’autre part, il peut être bon de se rappeler qu’aimer l’objet c’est aussi aimer ceux qui l’on fabriqué. Pourquoi opposer l’attachement aux choses à l’attachement aux gens alors que derrière chaque objet, il y a une volonté et un travail humain ? Il y a des efforts et du génie déployés par d’autres qui permettent de nous faciliter la vie. Faites l’exercice de vous demander qui sont ceux qui ont produit tous les biens qui vous rendent service au quotidien et vous aurez de quoi vivre des experiences vertigineuses rien qu’en parcourant les rayons d’un supermarché !
-
Posséder plutôt que louer est enfin un facteur d’indépendance, de résilience et de liberté.
Posséder c’est aussi ne pas être tributaire d’autres personnes, ne pas avoir besoin de rendre des comptes, avoir le contrôle de l’outil. Or en cas de crise, lorsque les ressources se font rares, que la confiance diminue ou que quelques acteurs prennent le contrôle des outils communs, avoir su conserver la propriété sur les choses devient un atout inestimable.
Conclusions
Les XIXème et XXème siècles ont vu l’argent devenir de plus en plus liquide ; la monnaie papier a remplacé la pièce de monnaie métallique, L’étalon or a été aboli, la création monétaire a été privatisée, les outils de communications se sont développés de manière exponentielle facilitant toujours plus les échanges financiers et les nouveaux produits financiers se sont multipliés pour encourager chaque jour davantage la liquidité des marchés.
Les conséquences sur l’économie ont été énormes, et les effets sont aussi bien positifs que négatifs. D’un coté, l’économie est devenue plus fluide et plus efficiente, les ressources dormantes ont pu être mises à disposition de ceux qui avaient besoin de l’usage de l’argent pour investir. Les interactions entre les gens et entre les peuples ont augmentées de manière considérable.
Mais de l’autre coté, les nations et les particuliers se sont endettés comme jamais auparavant les plaçant dans un état de dépendance de moins en moins compatible avec la démocratie et la souveraineté des peuples, les richesses se sont concentrées, les bulles et les crises financières se sont succédées générant une instabilité croissante… Les consommateurs et les acteurs financiers se sont déresponsabilisés, les uns en pensant pouvoir acceder au crédit sans conséquences, les autres pouvant jouer sans limite et sans contrôle avec l’argent d’autrui…
Voici quelques conséquences de l’argent devenu liquide. Les objets liquiéfiés suivront-ils la même voie ? Le parallèle a ses limites mais permet tout de même d’éclairer un peu le devenir d’une économie de l’accès dans laquelle ils deviennent des actifs liquides et d’en limiter quelques aspects potentiellement néfastes.
L’économie de fonctionnalité rend l’economie plus efficiente, elle généralise et facilite l’accès à l’usage fonctionnel de choses qui étaient hors de portée de beaucoup, elle augmente la sociabilité et les rapports humains et a un impact écologique positif car elle rompt avec l’idée qu’un bien s’inscrit en bout de chaîne destiné à être consommé ou devenir obsolète.
Mais l’idée que l’usage doit primer sur la possession comporte aussi ses effets pervers qu’il convient de souligner pour faire un travail honnête et efficace.
En ne permettant pas de projeter facilement des pans de sa psyché sur des objets qui ne nous appartiennent plus, l’économie de l’accès court le risque de réduire l’objet à la fonction pratique, purement utilitaire et de nous priver de cette amitié avec les choses. Elle peut également mettre en danger l’appropriation créative des objets qui est un facteur favorisant l’innovation. Elle est une perte d’indépendance et de résilience qui nous place sous la tutelle de ceux qui veulent bien nous laisser accéder à certains usages quand cela leur convient. Elle favorise certes la relation et le volume d’interactions sociales mais elle en modifie la nature vers une plus grande merchandisation des relations. On va vers l’autre parce qu’on a besoin de lui pour acceder à des services et non pas de manière désintéressée.
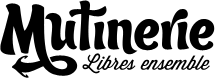



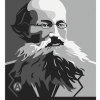



vraiment très bel article. tout seul dans la foret, je préfère mon opinel a un service dans le cloud ;=) un objet a une fonction symbolique Cf: succès de Nokia dans le GSM et d’Apple. l’animisme en quelque sorte – a Relire, le systeme de objets Beaudrillard et Mythologie de Barthes.
J’aime beaucoup la profondeur de la réflexion, comme toujours d’ailleurs, mais surtout j’apprécie l’honnêteté des conclusions.
Cela manque souvent dans des contextes que je définis parfois excessivement enthousiastes de tout ce qui est nouveau et 2.0
Ça doit prendre longtemps d’écrire tout ça non?
Merci!
Hahaha oui ça prend du temps d’écrire ça !
Merci francesco, je partage aussi l’idée de se méfier de l’enthousiasme excessif et d’essayer de regarder les choses au fond. c’est, sur le long terme le meilleur service que l’on peut rendre à ces mouvements qui m’enthousiasment moi-même et dans lesquels je baigne.
Il faut du temps pour écrire, en effet, mais aussi pour lire !!
A part les quelques fautes (d’accents manquants, notamment, la « merchandisation des relations « ! acte manqué de l’auteur qui pensait à certaines relations humaines « merdiques »), et les redondances (la reformulation pédagogique !), j’ai trouvé très intéressant de nous faire réfléchir sur le nécessaire équilibre entre posséder des biens ou produits et les utiliser via location, partage, usufruit.
J’ajouterai l’exemple de l’immobilier : louer son appartement/sa maison ou être propriétaire ? D’un côté, on fluidifie les choses, on peut changer plus facilement de travail/de région, de l’autre, on peut changer le logement, mettre sa patte personnelle, développer une créativité folle, avoir un patrimoine pour ses vieux jours.
Mais, avec la location, on est soumis à un marché très difficile, avec des coûts d’usage qui peuvent devenir prohibitifs, à l’image des opérateurs de téléphonie mobile qui font payer nettement plus cher le mobile à travers leurs forfaits.
Avec l’accès à la propriété, on devient l’otage des crédits bancaires et on freine considérablement la mobilité professionnelle, un des maux de notre économie française.
Alors, comment faire ? La solution est sans doute en chacun de nous. L’idéal serait de pouvoir faire les deux (louer et acheter deux biens différents), en tous cas de passer de l’un à l’autre avec une meilleure fluidité. Je suis très désolé/étonné par exemple lorsque je vois des retraités qui n’ont pas acheté leur appartement ou maison, car symboliquement autant que financièrement ils vont avoir de gros soucis pour vivre correctement.
C’est un peu pareil pour le coworking ! Je crois qu’on peut faire les deux : d’une part, travailler/rencontrer/créer de façon collaborative, grâce aux lieux qui le favorisent (les vrais, pas les centres d’affaires qui tentent de récupérer le mot pour le buzz commercial !) ; d’autre part, travailler de son lieu de référence, son nid, son point d’amarrage, que ce soit chez soi, pour les indépendants, avec ses collègues ou associés pour les entrepreneurs ou salariés, etc.
Bonjour,
tout d’abord bravo pour cet article très intéressant. Cependant, j’ai l’étrange sensation que la formulation de la question et l’entrée dans la propriété d’usage comportent en elles une possibilité qui, bizarrement, n’est pas exploitée, ce qui nous laisse penser qu’on reste sur un dilemme entre propriété et location. Pourtant, la propriété d’usage est là pour ne pas posséder (et donc se situer dans un schéma inégalitaire et de domination [voir Rousseau « la propriété comme fondement de l’inégalité parmi les hommes »]) tout en s’appropriant (le temps de son usage, on peut tout à fait s’approprier et faire évoluer un bien, un logement par exemple, et l’adapter à l’usage qu’on en fait, à sa créativité, justement parce qu’il n’a pas de propriétaire à qui on doit le rendre en l’état). Un collectif d’usagers peut donc permettre les deux dimensions par la propriété d’usage, et ne pas rester dans ce dilemme que je croyais voir disparaître au sein de cet article.
pour la propriété d’usage dans l’immobilier, voir le CLIP : http://clip.ouvaton.org/
pour une dimension globale, voir l’usologie de prosper (http://www.prosperdis.org/n_spm.php) et la désargence (desargence.org).
bien à vous
En tant que « produit de la nature » destiné à disparaitre, nous les humains, nous avons fait de la propriété notre bouclier et de la descendance notre seule garantie pour perdurer. Regardons de l’autre côté du globe, l’Extrême-Orient: là-bas, on parle de l’impermanence des choses. L’angoisse de posséder n’a pas de raison d’être car tout est périssable. Alors, on se contente simplement de vivre l’instant présent et surtout, d’en être conscient. On partage une tasse de thé avec l’ami qu’on peut ne plus jamais revoir. On s’arrête un instant sur le chemin pour regarder une fleur éclore. Dans un tel état s’esprit, les peurs s’estompent d’elles-mêmes et laissent place à une communion avec la nature qui nous entoure et les objets, qu’on possède ou pas, mais qui nous touchent. On s’en détache et on s’en éloigne le coeur léger et l’âme en paix. La sagesse de cette civilisation devrait nous interpeller et nous amener à réfléchir sur notre mode de fonctionnement: accumuler les richesses pour se dire qu’on est à l’abri, puissant, quasi-immortel? Posséder l’objet convoité parce qu’on s’imagine qu’on peut le garder à vie (vaine quête hélas). Je m’éloigne du sujet William et je peine à établir un lien entre ta réflexion et mon commentaire. Simplement, je pense que dans notre monde dominé par l’appât du gain, du pouvoir et de la dominance, notre humanité s’évanouit comme un rêve… Merci pour cet article! J’attends toujours de te lire avec impatience