Le travailleur du XXI ème siècle est-il en train de revenir, sans s’en apercevoir au mode d’organisation du travail paysan traditionnel ? Cette question peut paraitre saugrenue de prime abord tant l’image du développeur devant son ordinateur peut paraitre éloignée de celle du paysan. Mais pourtant, si l’on va au delà des outils et des supports, on s’aperçoit qu’au delà de la nature des tâches effectuées; les modes d’organisation ne sont pas si différents.
Dans l’économie numérique, on parle de pollinisation, d’écosystème, de viralité … Autant de termes empruntés aux logiques biologiques. Et ce n’est pas complètement un hasard. Les logiques biologiques inhérentes à la production agricole se retrouvent dans l’économie numérique et impliquent des méthodes de production sans doute plus proches entre elles que de celles héritées de l’âge industriel.
Voici à mon sens, les principaux points communs entre le travail agricole et le travail numérique :
Des systèmes complexes
Le travail industriel manipule essentiellement de la matière inerte (charbon, métal, béton etc.) soumise à des lois strictes et invariables, les lois de la physique, de la résistance des matériaux … En terme d’organisation, des lois invariables permettent de construire des modèles fiables et optimisés et autorise donc un travail standardisé aux horaires fixes et aux procédures rigoureuses. C’est ainsi que l’on a pu écrire des formules affirmant que la production était la résultante d’une certaine combinaison entre le travail et le capital, chose qui ne s’applique correctement ni à l’économie agricole traditionnelle, ni à l’économie numérique.
Portés par ces croyances héritées du succès dans nos méthodes industrielles, nous avons commencé à les appliquer dans l’agriculture. Le problème, c’est que l’agriculture travaille à partir du vivant, soumis à d’autres lois. Car le vivant, attrape des maladies, craint les averses de grêle et interagit avec d’autres êtres vivants. Le vivant est en interaction constante avec son environnement, qui le modifie et qu’il peut lui-même modifier.
Autrement dit, manipuler du vivant c’est manipuler un système complexe, et la création de valeur dans un système complexe fonctionne de manière radicalement différente.
Qui dit système complexe dit absence de rétroaction systématique, de capacité à prévoir, à généraliser ou à systématiser car le nombre d’acteurs en interaction est trop grand et leurs liens sont trop enchevêtrés. Ainsi, selon Wikipédia une réaction chimique, comme la dissolution d’un grain de sucre dans du café, est simple car on connaît à l’avance le résultat : quelques équations permettent non seulement de décrire les processus d’évolution, mais les états futurs ou final du système. Il n’est pas nécessaire d’assister au phénomène concret ou de réaliser une expérience pour savoir ce qui va en résulter en réalité. Au contraire, les cellules nerveuses de notre cerveau, une colonie de fourmis ou les agents qui peuplent un marché économique sont autant de systèmes complexes car le seul moyen de connaître l’évolution du système est de faire l’expérience, éventuellement sur un modèle réduit.
Organisation par écosystème
La seule approche valable dans un système complexe est holisitique, puisque la somme de l’ensemble ne peut être réduite à l’addition des éléments qui le compose.
On ne peut appréhender un élément que dans son écosystème, c’est à dire en tenant compte dès le départ de ses interactions avec les autres agents.
L’économie rurale traditionnelle intègre cette logique. Les parties non consommées du blé font du foin pour le bétail, dont les déjections font ensuite de l’engrais pour les récoltes. les ruches à proximité des vergers aident les arbres à produire plus de fruit tout en produisant du miel. Les habitants s’aident mutuellement pour les récoltes, les paysans échangent leur outils et mutualisent les ressources. La clé du succès agricole n’est pas seulement dans la capacité de travail ou la rigueur de l’organisation de son entreprise mais également dans la richesse de l’environnement alentour. L’entité exploitation agricole ne se distingue pas entièrement de son environnement et ne peut être vraiment analysé sans lui. L’économie rurale traditionnelle est donc une économie circulaire et collaborative comme le devient de plus en plus l’économie numérique.
Que se soit la Silicon Valley, la scène berlinoise ou les autres lieux réputés féconds sur les domaines de l’économie numérique, on retrouve cette logique d’écosystème où le succès d’un agent s’explique largement par la richesse du terreau qui lui a permis de naitre et de grandir.
Capacité d’observation, disponibilité et sérendipité
Le paysan, comme le designer web savent parfaitement que la productivité n’est pas linéaire. On aura beau être le plus rapide du monde pour semer, pour récolter. Si l’on n’est pas présent au moment où la sécheresse s’installe ou lorsque la grêle s’abat sur les récoltes, la production finale sera en partie détruite. De même s’il n’observe pas à temps l’arrivée de parasites ou de maladies.
Ainsi, pour le paysan, la productivité est liée à une forme de disponibilité et de vigilance dans des moments aussi importants qu’imprévus plus qu’à une capacité d’exécution stakanoviste.
Le designer, à la recherche de l’idée brillante pour repenser l’expérience utilisateur d’un service en ligne sait que celle-ci pourra surgir lors d’une discussion anodine ou en observant le fonctionnement de son restaurant d’à coté… Il en va de même pour des pans entiers du travail numérique dans lequel la créativité, la veille, la disponibilité et la capacité à saisir des opportunités nées de l’environnement sont indispensables.
Polyvalence et indépendance
Comme le travailleur numérique, le paysan traditionnel est la plupart du temps indépendant et polyvalent. il travaille « en mode projet » sur des missions souvent différentes. le bricolage d’une clôture n’a rien à voir avec l’entretien de ses vignes ou la vente de ses produits sur le marché et pourtant, toutes ces tâches sont essentielles à la réalisation du projet central.
Ils sont des « hommes-projets » et non pas des « hommes-fonctions » ce qui implique une grande polyvalence et un art consommé de la démerde.
Esprit de Bidouille
Dans l’économie numérique, beaucoup s’extasient régulièrement sur le Lean et les principes de cycles courts d’essais, d’implémentation et de pivot. On met en avant l’esprit de bidouille des travailleurs du numérique, du développeur, du hacker mais ces logiques se retrouvent déjà depuis des siècles dans l’agriculture où l’on fonctionne par test et implémentations successives. Cette terre parait bonne pour les asperges ? essayons à petite échelle et voyons si cette hypothèse est validée. Cette variété me parait plus adaptée à mon environnement ? testons-la…
L’esprit de bidouille est une qualité majeure pour évoluer plus aisément dans un système complexe dans lequel l’expérimentation est la clé de la compréhension.
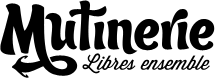



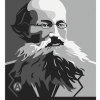



Très intéressant ! Je découvre dans cette article tout plein de similitudes entre deux mondes que je n’aurais pas pensé à comparer…
On voit que l’expérience percheronne, encore balbutiante, porte déjà ses fruits !
Les articles de la Mutinerie créent le monde qui naît sous nos yeux en même temps qu’ils le décrivent. Vraiment, je viens chercher ici de nouvelles visions du monde. « Les pensées qui mènent le monde arrivent sur des pattes de colombes ». Ou bien des pattes de mutins.
Et bien, ce n’est pas rien ces compliments ! Merci beaucoup vraiment …
Belle comparaison ! J’étendrai même le concept plus loin en l’appliquant à tous les métiers actuels exercés en indépendant : le freelance est forcément un homme-orchestre ! Et oui c’est un combat, aussi bien pour les paysans qui veulent rester paysans et non pas « ingénieurs agricoles », que pour les indépendants qui veulent rester indépendants justement !