Mutinerie continue ses plongées spatio-temporelles dans les lieux de travail qui ont changé l’histoire. Après le monastère à l’époque médievale, nous nous attaquons au Kibboutz, ces villages collectivistes émergés en Palestine à partir du début du XXème siècle.
Pour cet article, j’ai fait appel à Léonard Déage, un ami non seulement féru d’histoire mais ayant également testé la vie dans un Kibboutz pendant 6 mois à la fin de ses études. Il sait donc de quoi il en retourne sur ces questions. Rappelons ce qui nous intéresse dans ses flashbacks historiques; comprendre comment des espaces de travail et de vie innovants sont nés, se sont organisés et ont su modifier le cours de l’histoire. Dans ces expériences du passé résident sans doute de nombreux enseignements pour ceux qui tentent actuellement de changer nos façons de vivre et de travailler.
Contexte de la fondation du premier kibboutz : Degania
L’Empire russe de la fin du XIXe siècle connaît de graves troubles politiques, et les émeutiers finissent souvent par se retourner, notamment lors de l’assassinat de l’Empereur Alexandre II, en 1881, contre les très nombreuses communautés juives installées sur les actuels Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Pologne et pays baltes.
Parallèlement, les idées sionistes mettent en effervescence les milieux intellectuels laïcs de la Diaspora occidentale : Théodore Herzl publie son Der Judenstaat (L’Etat juif) et réunit le premier Congrès sioniste à Bâle, en 1897.
Ces idées suscitent un enthousiasme particulièrement fort au sein des communautés d’Europe orientale, qui subissent régulièrement de violentes persécutions, et qui restent soumises à des lois discriminatoires.
On assiste alors à plusieurs vagues d’immigration successives vers la Palestine (de l’ordre de 50 000 personnes entre 1881 et 1914), alors sous domination ottomane. De petites équipes se forment et s’installent sur des terres préalablement acquises par le Fonds National Juif (KKL), et dont l’exploitation leur est concédée.
Pour ces jeunes pionniers, qui le plus souvent ne savent rien de l’agriculture, il s’agit maintenant de survivre, de défricher, drainer les marécages, dépierrer les champs, planter des arbres… Beaucoup se découragent et vont plutôt tenter leur chance en Europe occidentale, aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud.
Si la volonté de ces pionniers est bien de créer un Juif nouveau, vivant du travail de la terre et de ses mains (métiers qui avaient longtemps été interdits au Juifs, dans les ghettos d’Europe), loin de toute exploitation de l’homme par l’homme, et si les vétérans du Bund et autres partis socialistes ouvriers juifs sont nombreux, tous ne sont pourtant pas des socialistes convaincus.
En l’absence d’un courant politique dominant et dogmatique, et devant l’extrême diversité de cultures, de langues et de mode de vie des immigrants juifs, de nombreuses expériences d’organisation coexisteront au début. Cela donnera aux Kibboutz une démarche expérimentale indéniable.
La rudesse du travail, dans des champs restés en jachère pendant des siècles, l’isolement géographique, et parfois la nécessité de faire face aux menaces des tribus bédouines environnantes rendent en fait le travail et la vie en communauté indispensables à la réalisation de cet idéal. Les fermes qui ne fonctionnent pas sur des principes égalitaires, avec propriété collective des moyens de production, périclitent ou explosent.
C’est dans ce contexte qu’en 1909 est fondé Degania, au bord du Lac de Tibériade, en Galilée. C’est dans ce kibboutz que de nombreux pionniers seront formés, pour essaimer ensuite en fondant plus loin de nouveaux kibboutzim, dans l’idée de pouvoir revendiquer l’occupation d’un maximum de territoire avant la proclamation prochaine de l’Etat d’Israël et le partage des terres qui s’ensuivrait.
Fonctionnement d’un kibboutz type
Le principe de collectivisme ne s’arrête pas à la propriété et à la coopérativité, mais s’applique aussi à la vie sociale (les repas sont pris en commun dans une grande salle, etc.), à l’éducation (les enfants sont élevés par groupes d’âge, et ne voient leurs parents que quelques heures par jour). Les décisions concernant le kibboutz sont soumises à un régime de démocratie participative directe.
L’administration est réduite au strict minimum, ce qui est rendu possible par le fait qu’en moyenne un kibboutz compte moins de 450 membres, mais pas non plus sans rapport avec un fond de culture anarchiste. Les postes administratifs sont tournants.
Après les dépenses de fonctionnement et les dotations aux investissements, les revenus sont partagés équitablement entre les membres, selon la taille des familles, et les services sont gratuits (école, dispensaire, buanderie, installations sportives, dans une certaine mesure la restauration collective, …). Ces revenus sont d’ailleurs essentiellement versés sous la forme d’un budget (« droit à dépenser dans l’enceinte du kibboutz »), et seulement en partie sous forme de salaire en monnaie courante (pour les achats personnels en dehors du kibboutz).
Cependant, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les kibboutzim ne fonctionnent pas en autarcie (ils ne peuvent pas produire tout ce qu’ils consomment), mais ils sont même liés à l’Etat de manière relativement importante. Ils exploitent des terres qui lui sont concédées par l’Etat, et ont touché (jusqu’à l’arrivée du premier gouvernement de droite, en 1977) d’importantes subventions. De plus, les kibboutzim ont historiquement fourni un important contingent à l’administration publique et à l’armée.
Après la proclamation d’indépendance et la première guerre israélo-arabe, en 1948, les kibboutzim contribuent aussi largement à l’absorption du flux d’exilés juifs issus des pays de l’Orient arabe, puis après l’indépendance des pays du Maghreb dans les années 60, puis après l’ouverture partielle de l’Union soviétique dans les années 70, et depuis son effondrement en 90.
Le kibboutz constitue alors une première étape – une sorte de sas de décompression – pour les nouveaux immigrants, au cours de laquelle sont dispensés, dans des écoles dédiées, des cours d’hébreu et des conseils pratiques (formalités, ouverture d’un compte bancaire, enregistrement à la Sécurité Sociale, …).
A noter que, à de rares exceptions près – une vingtaine de kibboutzim religieux sur 271 -, les kibboutzim sont laïques (voire un peu bouffe-rabbin…), et ne retiennent par exemple des fêtes juives traditionnelles que leur origine agricole ou leur sens national.

Héritage
Après une période de crise dans les années 70, certains kibboutzim ont mené de profondes réformes, de l’instauration progressive de salaires différenciés à la privatisation pure et simple, en passant par la constitution en moshav (autre structure, plus proche de la coopérative classique).
En tendance, on a assisté à un recentrage de la vie privée sur la cellule familiale ; c’est ainsi que les enfants sont aujourd’hui majoritairement élevés par leurs parents, que les repas ne sont plus pris systématiquement en commun, et qu’une plus grande partie du budget est versée en monnaie.
De plus, conséquence d’un niveau globalement élevé d’éducation, le kibboutz s’est ouvert sur l’extérieur : en embauchant de la main-d’œuvre non-membre pour les travaux les moins qualifiés, et en permettant aux membres de travailler à l’extérieur (à condition de reverser la plus grande partie de leur salaire à la collectivité).
Aujourd’hui, les kibboutzniks ne représentent plus qu’1,8% de la population israélienne. Pourtant les 271 kibboutzim contribuent à 40% de la production agricole, 10% de la production industrielle et 6% du PIB d’Israël.
Mais surtout le kibboutz a donné au pays une étonnante proportion de ses hauts cadres militaires et politiques, et parmi les personnalités les plus engagées et les plus militantes socialement.
Jusque dans les années 80, il a constitué pour la société israélienne un modèle vers lequel tendre, et s’il ne jouit plus du même prestige qu’autrefois, il a durablement façonné la production, l’idéologie et la culture israéliennes.
Depuis les années 2000, le kibboutz connaît un regain de popularité et sa population croît de nouveau. Certains se sont en effet spécialisés dans des productions à haute valeur ajoutée : haute technologie, agriculture de pointe, industrie de l’armement, … Ils intègrent des bureaux de recherche et développement renommés dans le monde entier. D’autres encore se sont tournés vers les services : le tourisme essentiellement.
Le kibboutz reste une exception historique, et le mouvement communautaire le plus grand du monde.
Et le coworking dans tout ça ?
Quels enseignements le coworking peut-il tirer de l’expérience des kibboutz ?
- Exodus
Le contexte dans lequel émergent les Kibboutz est unique au monde. La création d’Israël est un exemple rare d’une création nationale essentiellement « bottom-up » ; un mouvement spontané de la base vers le sommet. Elle part d’une base de personnes qui, en dépit d’énormes différences culturelles, partagent un sentiment d’appartenance à une communauté mais ne peuvent espérer vivre selon leur aspirations au sein des pays dans lesquels ils résident.
Le kibboutz est conçu comme un refuge pour les gens persécutés, un moyen d’échapper à l’oppression et à l’exploitation.
Les premiers Kibboutzim emergent bien avant qu’Israël soit reconnu comme un Etat, il ont précédés celui-ci et lui ont permis de prendre forme. Le coworking est également un mouvement bottom-up, né d’abord d’un mouvement spontané et rejoint par une réflexion plus globale. Il comporte également cette dimension de refuge, de lieu de vie et de travail vivant hors des règles actuelles jugées dégradantes, inadaptées, injuste ou simplement obsolètes.
- Pas de communauté efficace sans idéal
Les Kibboutzim, comme les monastères du reste montrent qu’à partir du moment où des groupes humains sont unis par un idéal commun et une volonté réelle de vivre ensemble, il est possible de construire de grandes choses malgré une diversité culturelle colossale. C’est également quelque chose que le mouvement du coworking doit garder en tête. La diversité de profils et de compétences dans nos espaces ne peut être un véritable atout que si nous sommes capables de proposer et de maintenir un idéal commun partagé par tous.
Le modèle du kibboutz enseigne que lorsque l’on rassemble des gens partageant un idéal et qu’on leur donne les moyens de production, on peut potentiellement refaire société, au point de créer un Etat …
- L’équilibre entre l’idéal et le réel
Le modèle d’organisation des kibboutzim se dessine au fur et à mesure des différentes expérimentations. Ce qui a émergé c’est fait davantage par pragmatisme que par conviction politique. Ce qui ne veut pas dire que les pionniers n’avaient pas d’idées politiques, mais qu’ils n’avaient pas d’idée préconçue de la forme que celles-ci devaient prendre.
La fondation d’Israël est très rapidement (et violemment) confronté à la dure réalité, et un modèle comme celui du Kibboutz n’aurait pu continuer à exister s’il n’était pas capable de s’y frotter. Il a été façonné par le réel, sans perdre son idéal.
Tandis qu’en pleine Union Soviétique, on transforma l’idéal socialiste en objectifs concrets et en plans quinquennaux, les kibboutz s’employèrent à garder et maintenir cet idéal tout en faisant face au réalités quotidiennes de manière assez pragmatique. J’y vois là un enseignement important sur la manière de conjuguer l’idéal, la vision avec le fameux « mur de la réalité » qui terrifie, et qui bien souvent fini par aplatir bon nombre de nobles esprits …
- Les risques
Enfin, on voit aussi dans l’histoire des kibboutzim, les germes des dangers qui peuvent guetter ce modèle d’organisation. L’histoire des Kibboutzim, comme celle des monastères et celle des espaces de coworking comporte ses erreurs, ses tensions et ses divisions.
Pour les kibboutzim, le risque de la confusion entre l’action des communautés et celle des gouvernements est évident.
L’histoire de la fondation d’Israël et celle des kibboutzim ne cesse de s’entremêler au risque de provoquer une perte d’indépendance réelle pour les kibboutzim et une potentielle instrumentalisation de ces derniers au profit d’une politique d’Etat. Les kibboutzim ont clairement servi de verrou pour l’appropriation et la consolidation des territoires fraichement acquis et ont bénéficié d’aides et de subventions diverses.
On se retrouve bientôt pour découvrir un lieu de travail ayant changé l’histoire; les ateliers d’artiste au XIXème siècle
Si vous souhaitez contacter Léonard, le féliciter, le conspuer ou lui poser des questions, c’est ici.
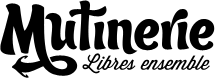



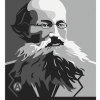


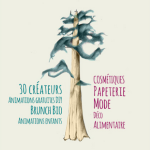
excellent article ! Je cherche à faire un Kibboutz Breton si vous avez des contacts.
Merci Lahogue, parle-moi un peu de ce kibboutz breton ça m’intéresse ! Mon mail : [email protected]
A bientôt,
William (l’auteur de ce billet)
lol j’ai pas vu ton message je t’envois un mail j’ai un apport de 200K€ je cherche 4 ou 5 mecs en CDI avec capacité d’emprunt. On propose une vingtaine de places pour un effort d’épargne mensuel de 150€.
Excellent article Léo !
Evidemment qu’il est excellent, cet article, Marie-Eva ; comment en aurait-il pu être autrement ?
Franck