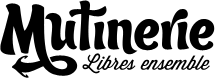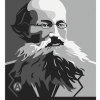A première vue, la nature est un vaste ensemble exubérant, chaotique et foutraque. Ca jaillit dans tous les sens, ça germe et ça meurt, ça donne des graines qui se perdent en vain, des progénitures dont les trois quarts des rejetons ne parviendront pas à l’âge adulte… Bref, ça ne ressemble pas à l’idée que l’on se fait d’un système optimisé. Pourtant, ce que nous voyions d’elle aujourd’hui est le résultat de millions d’années d’évolution, de lutte pour l’accès aux ressources, d’adaptation à des milieux changeants, parfois terriblement hostiles.
La nature est donc optimisée, mais elle est optimisée à une échelle supérieure; non pas au niveau des individus mais au niveau de son ensemble.
Optimisée dans le temps aussi parce que la nature s’est organisée pour « prévoir » l’imprévisible.
Un économiste pourrait dire que la nature a trouvé des solutions qui dépassent l’équilibre de Nash, c’est à dire les situations où la somme des intérêts individuels ne conduit pas à la solution idéale pour chacun. Prenons-en de la graine et observons la de plus près !
Le plus souvent, la nature évite la compétition. Elle la considère comme ce qu’elle est; une dépense d’énergie le plus souvent évitable. Lorsqu’elle le peut, les espèces essaient de l’éviter, en se spécialisant, ou en se répartissant le territoire.

La compétition n’est pas la règle générale de la nature, elle n’est qu’une possibilité parmi d’autres stratégies d’adaptation. Nous verrons plus tard qu’elle intervient surtout dans les milieux à la fois riches en ressources et relativement stables.
Ne pouvons-nous pas tirer quelques enseignements économiques de ces logiques biologiques ?
Le triangle de Grime
Le monde économique, comme le monde biologique est soumis aux mêmes contraintes fondamentales : la rareté, les perturbations de l’environnement et enfin la compétition. En cherchant des contenus autour de ces questions, je suis tombé sur John Philip Grime, un écologue américain qui inventa en 1974, un modèle de classification des plantes en fonction de ces critères qu’il synthétisa par un triangle : le Triangle de Grime. Il proposa un modèle universel d’adaptation de la flore qui peut s’appliquer à mon avis assez finement pour les entreprises.
Grime distingue trois différentes pressions qui agissent de manière variable sur l’environnent; la pression liée à la plus ou moins grande rareté des ressources, celle qui correspond aux niveaux de perturbation de l’environnement et enfin la pression compétitive des autres organismes qui convoitent les mêmes ressources.
Les stratégies qui s’appliquent dans les environnements pauvres en ressources donnent des stratégies de niche ; on retrouve ces stratégies dans les déserts, les montagnes ou les sous-bois. Ce sont les lichens, herbes pérennes, arbustes, ou autres cactus …
Les stratégies qui s’appliquent dans les environnements riches en ressources et relativement stables sont les stratégies compétitives. On les retrouve dans les forêts primaires des pays au climat tempéré ou des forêts amazoniennes. Ce sont les chênes, hêtres, séquoias et de nombreuses autres plantes vivaces. Enfin les stratégies efficaces dans les environnements exposés à des perturbations importantes sont les stratégies rudérales. Leurs représentants apparaissent les premiers pour repeupler des terrains perturbés ; jachères, incendies, labours. Ce sont souvent des plantes annuelles et une bonne partie de ce qu’on appelle les mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes actuelles de l’économie s’appellent WhatsApp, AirBnB, Uber, et les autres startups; petites pousses à la croissance exponentielle et à la durée de vie limitée.
Les GAFAs peuvent être vue comme d’anciennes entreprises rudérales en train de réussir leur mutation vers la compétitivité…. Elles colonisent les nouveaux territoires numériques, se nourrissent des crises économiques; jachères dans les terres fertiles de l’Occident, elles s’attaquent aux status quo et réclament des déréglementations. Elles « disruptent » et innovent. Elles se nourrissent de changement.
Les entreprises compétitives sont déjà établies sur des marchés mûrs et importants ; produits de grande consommation, secteur automobile, immobilier, BTP, secteur bancaire etc. Souvent de grande taille et d’un âge vénérable, elles croissent, lentement mais surement dans le terreau complexe des économies riches. Elles ont appris à résister aux aléas et se sont taillées pour la performance. Un coup d’oeil aux noms des entreprises qui composent le CAC 40 en donne un bel aperçu.
Enfin, les entreprises de niche, plus discrètes, moins tonitruantes, évoluent dans les recoins perdus du tissu économique. On les retrouve dans les PME ultra spécialisées d’Allemagne qui exportent des produit spécifiques et pointus aux quatre coins du monde. On les croise aussi, plus petites, dans les économies coupées des grands flux ou dans l’artisanat de luxe …
Je me suis permis d’emprunter à Grime son fameux triangle et de le détourner sans vergogne pour montrer comment il pourrait s’appliquer à l’analyse des entreprises. Voici le résultat :
Triangle de Grime des entreprises

Caractéristiques « biologiques » des entreprises

La parabole du klondike
L’analyse de Grime ne nous permet pas seulement de situer des entreprises dans l’environnement économique, elle nous permet aussi de comprendre les dynamiques entre celles-ci.
Pour illustrer ces dynamiques, plaçons-nous un coin perdu au fin fond de l’Alaska à la fin du XIXème siècle ; pas grand chose à dire. Quelques pêcheurs, quelques trappeurs survivent en relative harmonie dans cet environnement difficile. Une population rare mais stable, occupant de petites niches aux marges de la société américaine.
Puis soudainement, de l’or est découvert dans le lit du Yukon, et une frénésie s’empare de ce lieu paisible. C’est la rupture ! des pionniers, des prospecteurs se ruent sur place à l’affût de la moindre pépite. Les débuts sont durs, mais quelques-uns tirent leur épingle du jeu et s’enrichissent dans cet environnement auparavant ingrat. Très vite l’économie s’organise, il faut à ces mineurs de quoi se ravitailler, et de quoi soulager leur peine dans l’alcool et la sensualité. Des restaurant, des saloons et des femmes arrivent.
C’est l’époque pionnière, mais les campements situés à proximité des endroits les plus riches se transforment en villages puis en villes, le terreau s’enrichit, la société se complexifie. Les restaurants et les bars deviennent des chaines, les mineurs et les vendeurs de pelles s’organisent en société, on ouvre des banques, des églises et des prisons. On diversifie les activités et les pionniers sont peu à peu remplacés par de véritables entreprises, compétitives et bien gérées. C’est alors l’heure de la compétition …
On peut remplacer l’or du Klondike par le pétrole Qatari, les softwares californiens, ou les usines chinoises et retrouver les mêmes dynamiques…